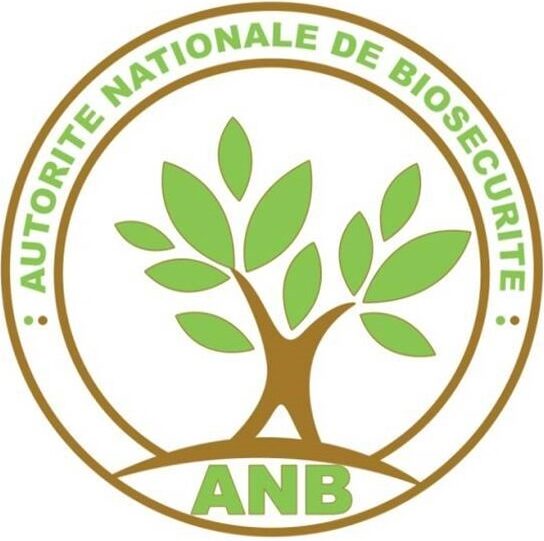Biotechnologies modernes et Analyse du risque
Pour une utilisation sécurisée des biotechnologies modernes, l’analyse de risque constitue une dimension importante qui guide le processus de prise de décision pour l’utilisation des OGM. Elle porte sur trois principaux aspects : l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication sur le risque.
L’évaluation du risque
L’évaluation des risques relève d’une démarche scientifique objective, menée au cas par cas, de façon comparative relativement à un contrôle approprié et en fonction de l’utilisation envisagée de l’OGM. Elle est basée sur un ensemble d’informations fournies, par l’utilisateur potentiel ou toute autre entité mandatée, à l’évaluateur. Ces informations permettent à ce dernier d’apprécier si les conditions maximales de sécurité pour l’environnement, la santé humaine et animale sont remplies, tout en tenant compte des aspects socioéconomiques. Les risques à évaluer dépendent de l’utilisation que l’on veut faire d’un OGM. De même, le niveau de confinement requis pour conduire les évaluations est aussi lié à la nature et à l’utilisation prévue de l’OGM.
L’évaluation des risques permet d’identifier les dangers probables et analyser leur impact potentiel sur l’environnement et la santé humaine ou animale. Elle doit permettre d’avoir des informations sur :
- l’estimation de la probabilité d’apparition des effets défavorables compte tenu du degré et du type d’exposition du milieu récepteur potentiel de l’organisme génétiquement modifié ;
- l’estimation des effets défavorables potentiels sur la santé humaine ou animale, sur la diversité biologique et sur l’environnement ;
- l’estimation du risque global présenté par l’organisme génétiquement modifié et les recommandations indiquant si les risques sont acceptables ou gérables.
A la suite de l’évaluation des risques, les projets et travaux de biotechnologie moderne sont classés en catégories de niveaux de sécurité (Loi 2022-20 portant sur la biosécurité).
Chaque niveau de risque appelle des mesures de sécurité particulières, qui peuvent être renforcées ou allégées en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques.
Il existe 4 niveaux de sécurité :
- Niveau de sécurité 1 : projets reconnus comme ne présentant pas de risque pour la communauté et pour l’environnement ;
- Niveau de sécurité 2 : projets reconnus comme présentant des risques faibles pour la santé humaine et animale et pour l’environnement ;
- Niveau de sécurité 3 : projets reconnus comme présentant des risques dont l’impact est considéré comme modéré pour la santé humaine et animale et pour l’environnement ;
- Niveau de sécurité 4 : projets dont l’impact sur l’environnement et sur la santé humaine et animale est établi comme formellement grave ou dont on ignore tout.
Ainsi, les évaluateurs doivent faire des recommandations indiquant si les risques sont inacceptables, acceptables ou gérables et au besoin, amender les stratégies proposées par le demandeur pour gérer ces risques.
Chaque recommandation doit être justifiée et documentée et doit mettre en exergue les niveaux d’incertitudes identifiée pour chacune des étapes du processus d’évaluation. Certaines incertitudes peuvent être réduites en demandant plus d’informations au demandeur ou en exigeant la mise en œuvre de mesures de gestion appropriées. Aucune recommandation ne doit être supposée comme définitive compte tenu du fait qu’elles sont basées sur le niveau de connaissance scientifique au moment de l’analyse et que les mesures de gestions proposées peuvent-elles même contribuer à générer de nouvelles informations susceptibles de modifier les recommandations.
La gestion du risque
Les mesures de gestion des risques ont pour objectif de prévenir, de réduire ou d’éliminer les effets défavorables de l’organisme génétiquement modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine et animale, et pour l’environnement. Pour le demandeur d’utilisation d’OGM, la présentation et l’approbation par les autorités compétentes, d’un plan de gestion de ces risques ainsi que l’adoption de mesures de confinement et de destruction appropriées des déchets issus de ces OGM, est obligatoire.
La communication sur le risque
La communication sur les risques est un domaine particulièrement sensible car il touche des aspects fondamentaux et ancrés profondément dans la nature humaine, à savoir ceux liés à l’instinct de survie, à la protection des siens, aux croyances.
La perception du risque en plus d’être émotionnelle est également analytique. La communication sur le risque devrait permettre de cadrer les perceptions des risques réels sans toutefois espérer éliminer totalement les réponses émotionnelles. La communication sur le risques vise de façon plus ou moins intentionnelle et explicite à :
- éduquer le public-cible à propos des risques, de leur nature, de leur évaluation et de leur gestion;
- informer le public-cible sur les risques spécifiques auxquels il est susceptible d’être exposé et aux actions prises pour les minimiser;
- fournir une occasion, un lieu ou un mécanisme permettant au public-cible d’exprimer ses préoccupations;
- améliorer la compréhension des préoccupations, attitudes et intérêts du public-cible;
- promouvoir la transparence et le partage d’informations;
- réduire les conflits et controverses non justifiées ou évitables;
- développer et améliorer la confiance mutuelle et la crédibilité
Ainsi, une partie de la difficulté de la communication sur les risques, particulièrement à propos des OGM, réside dans la nécessité de dépasser les perceptions négatives déjà ancrées de façon plus ou moins profonde dans au moins une partie du public.